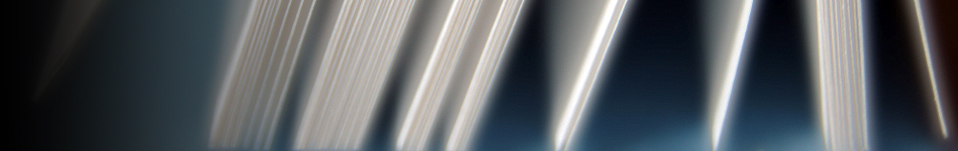Jean Claude Grumberg

(juillet 2004) Littérature, Shoah, poésie, théatre
Quelques extraits de l’entretien avec Jean Claude Grumberg en Juillet 2004
Auteur tragique "le plus drôle de sa génération", selon Claude Roy, Jean-Claude Grumberg s’est mis à écrire depuis quelques années des pièces de théâtre .
En 1945, vous aviez six ans, l’âge de l’éveil de la conscience. Quels souvenirs vous ont laissé vos retrouvailles avec votre mère au lendemain de la guerre, après une séparation de trois ans ?
Quand je revois ma mère je l’appelle Madame et je me cache derrière mon frère, comme si j’avais peur de la reconnaître. Je peux aujourd’hui me projeter dans la pensée de l’enfant que j’étais, mais je ne peux pas dire quel était le contenu de la réflexion de cet enfant. Quand j’avais un an, il y avait eu l’exode avec ma mère, mais on était revenu assez vite rue de Chabrol où se trouvait notre domicile et l’atelier de mon père. Celui-ci est arrêté en 1942, conduit à Compiègne, puis emmené à Drancy
Il a été ensuite libéré de Drancy, ce qui est très exceptionnel.
Il y a eu une commission qui libéra des gens pour raison médicale. Mon père fut de nouveau arrêté en 1942 et déporté ; ma mère nous envoie alors mon frère aîné et moi en zone libre. Nous passons la ligne de démarcation sous de faux noms avec une passeuse - que ma mère avait sans doute trouvée par l’OSE (organisation juive de secours aux enfants)- qu’on appelle "l’infirmière".
C’est ce qu’évoque "Zone libre" pièce montée à Paris avec l’extraordinaire Jean-Paul Roussillon. On y voit des juifs cachés à la campagne, complètement perdus parce qu’ils n’ont connu que la vie en ville, communiquant peu avec le paysan dont la culture est si éloignée de la leur.
En 1950, votre mère est confrontée à la formule administrative "Mort à Drancy" attachée à la date de départ des trains vers les camps de déportation.
Les femmes de disparus ont besoin de certitudes pour commencer leur deuil. Veuve c’est un statut, pas " femme de disparu". En 1950, l’administration fournit des actes de décès : c’est la loi pour toute personne disparue depuis plus de cinq ans. Sur le moment, cette formule "Mort à Drancy" ne retient pas notre attention. Moi-même, à l’époque, quand on me demandait : Profession du père, je répondais simplement : Déporté. Cette réponse ne provoquait aucune réaction.
En 1975, je commence à écrire "L’Atelier" qui comporte une scène autour de l’acte de décès avec un personnage, la patronne, qui ne supporte pas l’intitulé "Mort à Drancy". Lorsque la pièce est jouée en 1979, des spectateurs viennent me voir avec des actes de décès de leurs proches. Ils me disent : c’est insupportable. Peu après, les socialistes arrivent au pouvoir et Robert Badinter modifie la loi, sous la pression des associations. On obtient la possibilité de faire changer cet intitulé dans un bureau d’état civil en y apposant la formule "Mort au camp de déportation".
Après la guerre vous êtes devenu apprenti tailleur. Etait-ce la voie naturelle, celle qui s’imposait à vous ?
Non, pas du tout. A l’école je me distingue dans tout ce qui est oral. Je comprends les textes mieux que les autres. En revanche, je me refuse à tout ce qui est apprentissage réel, à tout travail, et je ne fournis pas d’effort, sauf en rédaction. J’avais une écriture illisible qui me valait des zéros. J’étais très malheureux. Je quitte l’école complémentaire pour suivre des copains qui vont dans un cours commercial. On nous parle de l’importance d’avoir une écriture lisible ; j’ai donc fait un effort et obtenu de bons résultats en rédaction. Quand on m’a attribué l’avant dernier prix, il restait deux livres : un livre d’aventure et Madame Bovary. Moi qui n’avais aucun livre chez moi, je choisis le livre d’aventure, mais mon professeur de français me donne un coup sur les doigts disant : "Prends celui-là et essaie de faire pareil." Bien sûr j’ai subi cela comme une injustice. J’ai souvent pensé avec émotion à ce professeur.
Après cette fin d’études je me retrouve apprenti. D’abord mon oncle marchand de meubles me présente à un tapissier. Celui-ci me met trois fauteuils sur le dos pour que j’aille les livrer, mais comme je m’écroule sous le poids au bout de trois pas, l’ apprentissage s’arrête là. C’est comme cela que je me retrouve apprenti tailleur tandis que j’adhère à l’Union des Jeunesses républicaines de France (en fait les Jeunesses Communistes). On m’y propose soit l’action militante – comme les collages d’affiches ou la vente du journal L’Avant-Garde - soit le théâtre. Je choisis de faire du théâtre. Peu après on me propose de jouer le rôle d’un gamin dans George Dandin. Dans ce groupe ils étaient tous plus âgés que moi et ils m’ont appris le métier d’acteur. Instinctivement, j’ai senti que mon apprentissage de tailleur était incompatible avec le théâtre. Au bout de quatre ans, je m’étais fait virer de 18 places, entre mon peu d’allant parce que je n’aimais pas cela et la fatigue des représentations ou répétitions tard le soir... Malgré la nécessité pécuniaire pour ma famille - mon frère de quatre ans mon aîné allait partir au service militaire – je refusais de devenir ce tailleur à la pièce, gagnant de l’argent en travaillant dur comme l’ont fait par exemple André Schwarz-Bart ou Robert Bober.
Votre premier texte était une pièce de théâtre ?
Oui. "Le duel" était une adaptation théâtrale d’une nouvelle de Tchékhov. Le texte a été publié chez Actes Sud en 2002, mais sur le moment mes copains de chez Fabbri m’ont seulement dit :"c’est bien mais qu’est-ce que tu veux qu’on en fasse" ?
Votre premier grand succès fut "Demain, une fenêtre sur rue", l’histoire d’une famille bourgeoise qui regarde par la fenêtre une émeute révolutionnaire ; puis les soldats viennent chez eux pour tirer sur les manifestants.
Elle ne m’a pas rapporté d’argent mais fut un énorme succès de presse. C’est ma première pièce jouée, à l’Alliance Française en 1968. A cette même période ont été écrites plusieurs pièces abordant cette situation, comme "Petits meurtres sans importance" .
Votre statut d’auteur date donc de ce succès mais votre travail d’écriture s’est fait de plus en plus personnel, abordant les drames de la deuxième guerre mondiale. "Dreyfus" est une pièce qui répond à cette préoccupation.
Dans "Dreyfus", une troupe d’amateurs yiddish de Wilno (Vilnius) qui a l’habitude de jouer le répertoire traditionnel se voit demander par un jeune metteur en scène de jouer l’histoire de Dreyfus. C’est un énorme succès en 1973. Des juifs sont les personnages principaux tandis que les étrangers sont des Polonais. C’est comme un retour : on peut enfin se revendiquer comme juif. Le sionisme et le communisme y sont présentés, mais ressentis comme deux échecs avec une ironie typiquement yiddish. Mais ce succès s’accompagne d’un sentiment de malaise : il faut que je m’attèle à un sujet que personne d’autre que moi ne peut raconter.
Vous commencez donc à travailler à "L’atelier"…
Quand j’avais quitté les ateliers et que je m’étais retrouvé chez Jacques Fabbri, tous ces gens que j’avais croisé dans les ateliers m’ont cruellement manqué. Je pouvais admirer certains de mes nouveaux compagnons qui étaient Pieplu ou André Gilles, mais les conversations évoquaient rarement des sujets essentiels.
Dans les ateliers, il y avait une vie très laborieuse mais les comportements étaient marqués par les souffrances passées. C’est cet approfondissement d’humanité des survivants que vous parvenez à communiquer.
J’ai fini par jouer moi-même le rôle du patron parce que les acteurs qui lisaient la pièce le percevaient comme un salaud et que moi je voulais glorifier les petits patrons. Ce n’étaient pas des négriers ; les premiers qu’ils exploitaient c’étaient eux-mêmes.
Ce travail sur vous-même ne vous a-t-il pas renvoyé à tout ce qui était occulté de votre enfance ? Ce qui fait votre force, n’est-ce pas cet humour désespéré en face de ce qui ne peut pas être réparé ?
Cela s’est passé par des ébranlements successifs, d’abord la mort de mon premier enfant. Il y eut ensuite le fait d’avoir du succès. L’analyse m’a permis de revenir sur le personnage de mon père. J’ai alors commencé à écrire des textes qui composent Mon père, Inventaire.
C’est un mémorial qui articule des textes pour en faire comme un costume de passé Vous y montrez à la fois les incohérences de la mémoire et les bribes d’hier qui remontent à la surface.
Ce qui compte pour moi c’est de raconter mon histoire. Cela me fait du bien. Il faut que j’intéresse les gens, mais je ne veux pas qu’ils me plaignent.
Vous avez abordé un tout autre registre avec les livres pour enfants. Quelle place y accordez-vous dans votre travail ?
Un de mes amis dirigeait un théâtre à Londres et avait l’obligation, cette année-là, de monter une pièce pour enfants, inédite. Il me propose cette commande en me promettant une belle traduction en anglais par un ami poète Adrian Mitchell. Je rentre chez moi en pensant écrire une "fausse pièce pour enfants" Mais il me précise qu’il faut s’adresser à des enfants de 5-6ans : je me force alors à écrire "Le petit violon". A la première représentation, à Londres, je vois des petits enfants de toutes les couleurs, des sourds-muets et des aveugles : toute l’humanité est là. Je me dis d’un seul coup : c’est là que je suis utile, c’est là que se fabriquent les citoyens.